Item a été reçu le 28 octobre dernier par le Cardinal Arinze pour une interview.
Entretien réalise par l’abbé Claude
Barthe et Valérie Houtart
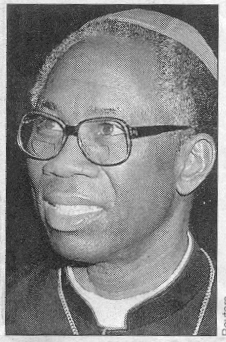 |
||
Valérie Houtart, Présidente d'Entraide et Tradition, responsable d'Item |
Cardinal Arinze, Préfet de la Congrégation pour le Culte Divin |
Monsieur
l'abbé Claude Barthe, Théologien pour la revue Catholica |
Peut-on remettre en ordre la liturgie de Vatican II ?
La
liturgie n’est pas de la « cuisine maison » : un entretien du cardinal Arinze
Un manque de foi et de révérence
Mgr Arinze, Vous êtes aujourd’hui Préfet
de la Congrégation du Culte Divin et vous êtes de langue anglaise. On dit
qu’un des problèmes liturgiques qui préoccupent le plus les autorités romaines
attentives aux dérives post-conciliaires est celui des traductions défectueuses
en matière liturgique et biblique, spécialement en anglais. Pourriez-vous
nous en parler ? Par ailleurs, les célébrations sont en elles-mêmes des
« traductions » de la foi de l’Eglise. L’encyclique Ecclesia de Eucharistia avertit qu’il y a un grave déficit dans la
liturgie telle qu’elle est souvent célébrée. N’est-elle pas souvent une « mauvaise
traduction » de la doctrine eucharistique ?
Cardinal Francis
Arinze – Vous mettez
beaucoup de choses dans votre boite à questions !
Parlons d’abord des traductions. Un
document de ce dicastère du Culte divin, il y a trois ans, Liturgiam authenticam, avait pour thème principal :
l’Eglise approuve les langues locales, dans la liturgie, mais les traductions,
dans le rite latin, doit être fidèle au texte originel latin. La directive
générale est celle-ci : toutes les traductions faites il y a trente ans
doivent être révisées de telle sorte qu’elles soient vraiment fidèles au texte
originel. Il est vrai que dans certaines langues, il est très difficile de
faire une traduction littérale. Mais on ne doit pas admettre des traductions
idéologisées. Par exemple, lorsque le missel latin fait dire au prêtre :
Orate fratres ut meum ac vestrum sacrificium
acceptabile fiat apud
Deum Patrem
omnipotentem
[1]
, un traducteur qui n’accepte pas de faire la différence
entre le peuple et le célébrant dira : « Priez mes frères afin que
notre sacrifice, etc. » C’est cette sorte de traductions idéologisées
que l’on doit éviter. Mais il ne s’agit pas seulement de la langue anglaise !
Même les Français… Regardez donc comment vous traduisez l’Orate frates…en
français : « Prions ensemble au moment d’offrir le sacrifice de
toute l’Eglise ». C’est tout. Ce n’est pas une traduction, c’est une
belle phrase, une très belle phrase, mais ce n’est pas une traduction du texte
latin. La réponse à l’invitation du prêtre est dans le missel latin :
Suscipiat Dominus sacrificium
de manibus tuis ad laudem et gloriam nominis sui, ad
utilitatem quoque nostram, totiusque Ecclesiae suae sanctae
[2]
. Et que dites-vous en français ? « Pour
la gloire de Dieu et le salut du monde ». Ce n’est pas une traduction.
Mais les traductions ne sont pas la
cause principale des difficultés. Leur cause principale est que le célébrant
ne suit pas le texte approuvé. Si chaque prêtre suivait les livres liturgiques
approuvés par l’épiscopat du pays et par la Congrégation romaine agissant
au nom du pape, il y aurait beaucoup moins de problèmes et d’abus. Le problème
vient de ce que pas mal de prêtres croient que la créativité est la grande
chose à promouvoir. Chaque prêtre, selon eux, doit célébrer la messe pour
montrer qu’il a une personnalité propre qui fabrique une chose bien à lui
en inventant chaque fois quelque chose de personnel.
Mais les rites de la liturgie de Paul VI n’incitent-ils pas eux-mêmes
à une grande créativité ? Vous dites qu’il faut réviser les traductions.
Ne faudrait-il pas parfois réviser aussi les rites ?
Oui, c’est peut-être une bonne idée.
Mais le missel n’est pas coupable. Il est vrai qu’il donne de temps en temps
des choix, des possibilités, des alternatives. Par exemple, en commençant
la messe le prêtre peut dire : « La grâce de Jésus notre Seigneur, l’amour
de Dieu le Père, et la communion de l’Esprit Saint soient toujours avec vous ».
Il peut dire aussi : « Le Seigneur soit avec vous ». Et il
y a d’autres formes de salutation approuvées par les Eglises locales. Cette
possibilité de choix est une bonne chose. Réduire à une seule possibilité
serait un peu rigide. En ce sens-là, le missel n’est pas rigide. Mais non-rigidité
ne veut pas dire créativité, comme si le prêtre imitait une maîtresse de maison
qui présente le plat qu’elle a préparé à ses invités, en disant : « C’est
de la cuisine maison !» Il ne faut pas inventer, sauf quand c’est permis,
comme dans la prière universelle. Mais la collecte, la prière après la communion,
la salutation liturgique sont fixées. Si le prêtre
commence la messe en disant : « Bonjour à vous tous, j’espère
que vous avez bien dormi », ce n’est pas un salut liturgique, c’est une
banalisation du sacré. Ce n’est pas inscrit dans les livres liturgiques.
Mais ce qui est inscrit dans les livres liturgiques est-il intangible ?
Ne pourra-t-on pas y inscrire autre chose ?
Oui, on peut avoir des opinions sur
ce point. Certains peuvent dire que le missel d’il y a trente ans laisse trop
de liberté, etc… Ce missel a été fait par des hommes et non par des anges.
Vous savez, Eminence, à quel point le clergé français est sinistré :
il est presque en voie de disparition dans certains diocèses. Mais les jeunes
prêtres sont d’une sensibilité liturgique très différente de celle de leurs
aînés, qui ont « fait » le concile et Mai 68. Ils sont souvent
très proches de la sensibilité liturgique traditionnelle. Ne croyez-vous pas
qu’arrive le moment d’amorcer justement « une réforme de la réforme »,
un retour à une liturgie plus transcendante ?
Votre question présuppose que la liturgie
actuelle n’est pas transcendante. Sur cela il est permis d’avoir des opinions,
mais je crois que le problème principal est un manque de foi, de dévotion
et de révérence suffisantes. Si chaque prêtre avait foi et amour pour l’Eglise
et fidélité au sens liturgique, s’il célébrait avec beaucoup de conviction
et une grande révérence sans rien inventer, il y aurait beaucoup moins de
problèmes et le sens de la transcendance divine ne serait pas perdu. Il y
a des problèmes quand il y a trop de ce que j’ai qualifié de banalisation,
de désacralisation. Mais il faut dire que beaucoup de jeunes prêtres ordonnés
il y a dix ans ont plus le sens de l’Eglise. Les grands séminaires ont beaucoup
d’importance. Il faut voir un peu comment se passent les choses dans les grands
séminaires : il faut y donner une formation et pas seulement une information.
La disparition, en bien des endroits, des confessionnaux manifeste la carence
du sens du péché et le mépris des dispositions pour s’approcher du Corps du
Seigneur. Par exemple, en France, dans les enterrements, il arrive que tout
le monde communie, même les incroyants ou les non-catholiques,
et quand le prêtre explique qu’il est bon de se confesser quelquefois, il
se fait traiter de « fanatique ».
Dieu est saint, trois fois saint. Il
habite dans la lumière inaccessible. Que reste-t-il de notre religion si nous
ne reconnaissons pas que nous sommes des créatures et des créatures pécheresses ?
Nous disons dans le Notre Père : « Pardonne-nous nos offenses, comme
nous pardonnons aussi… » Nous devons accepter d’avoir péché et nous devons
accepter d’avoir besoin de pardon. La foi catholique n’a pas changé, et notre
foi nous dit que pour recevoir la sainte communion avec fruit, on doit être
en état de grâce sanctifiante et non pas en état de péché mortel. Péché mortel
veut dire offense grave contre Dieu ou le prochain. Les dix commandements
n’ont pas changé. Celui qui a violé l’un ou l’autre des dix commandements
en matière grave a commis un péché grave. Cet homme-là n’a plus la grâce de
Dieu en lui. S’il reçoit le Corps du Christ, il le fera comme Judas. Car il
est vrai que Judas a reçu le Corps et le Sang du Christ lors de la Cène, mais
il est vrai aussi qu’il n’était pas dans les bonnes dispositions. Non seulement
celui qui communie ainsi ne reçoit pas la grâce, mais il fait un nouveau péché,
un sacrilège, qui s’ajoute à celui qu’il avait avant de venir. C’est terrible !
On ne doit jamais faire cela et si un prêtre collabore en disant : « Venez
tous communier », et que quelqu’un qui n’est pas en état de grâce s’approche
de la sainte communion à cause de cela, ce prêtre au lieu de l’aider à aller
vers Dieu, l’entraîne au sacrilège. Le sacrilège n’est pas une invention de
l’Eglise, c’est quelque chose d’objectif. Saint Paul nous a dit que le discernement
est nécessaire : « Qui mange le pain ou reçoit la coupe du Seigneur
indignement sera coupable à l’égard du Corps et du Sang du Christ ».
Il serait beau que tout le monde soit en état de grâce et puisse recevoir
la communion. Mais chacun doit s’examiner lui-même et non examiner autrui.
S’il ne se trouve pas en état de grâce, il ne doit pas recevoir le Christ,
mais d’abord se confesser en acceptant d’être pécheur. Il doit dire :
« C’est ma faute, c’est ma faute, c’est ma très grande faute. Ce n’est
pas la faute du gouvernement ce n’est pas la faute de mon épouse, de mon fils ».
Il faut accepter cela tout simplement, et demander le pardon de Dieu, avec
la résolution de ne pas recommencer. Si vous n’acceptez pas de vous confesser
à un prêtre, c’est que vous n’acceptez pas la volonté du Christ qui a dit
à ses Apôtres : « Tout ce que vous délierez sur la terre sera délié
dans les cieux ; tout ce que vous lierez sur la terre… » L’Eglise
comprend ces paroles comme exprimant le pouvoir qu’elle a de remettre les
péchés dans le sacrement de pénitence. Ce sacrement reste très important.
On peut même juger de la santé spirituelle d’un peuple au fait que les fidèles
le pratiquent. Si d’ailleurs personne n’allait se confesser, j’aurais envie
de demander : « Etes-vous immaculés comme l’était la Vierge Marie,
conçue sans péché originel, ne commettant aucun péché personnel ? »
Si les plus grands saints allaient se confesser fréquemment, pourquoi n’irions-nous
pas nous aussi, nous confesser ? Les prêtres doivent donc encourager
les fidèles dans ce sens. C’est une manière de faire sentir la sainteté de
Dieu. Sinon, quelque chose manquerait à la religion du Christ.
Eminence, vous avez laissé entendre, en divers entretiens accordés à des
revues, qu’un plus grand espace de liberté devait être accordé au rite traditionnel
Pouvez-vous nous en dire ou nous en laisser entendre davantage ?
Après le Concile Vatican II, l’Eglise
a reçu le missel de Paul VI, comme après le Concile de Trente, elle avait
reçu le missel de Pie V. Mais le pape Jean-Paul II a dit que s’il
existait des groupes qui préféraient la messe que nous appelons tridentine,
l’évêque la permettait en indiquant le lieu et le temps. C’est la pratique
d’aujourd’hui.
Cette célébration de la messe tridentine
relève de la Commission Ecclesia Dei. Notre Congrégation du Culte divin
est pour sa part chargée de la célébration du missel d’aujourd’hui. Le souci
de notre Congrégation est la fidélité au rite sacré. Pour le reste l’Eglise
de France et les Eglises de tous les autres pays examinent les solutions.
Il ne serait pas juste que je donne une recette, ni pour la France, ni pour
chaque pays du monde, mais notre Congrégation est ouverte à toute discussion.
Le primat de la mission
Eminence, vous venez d’un pays, le Nigeria, qui a cette singularité, avec
l’ensemble du catholicisme africain, d’être aujourd’hui en croissance numérique.
Le renouvellement du clergé y est assuré, puisque votre pays est celui qui
a le plus de séminaristes par prêtre (1,19 séminaristes par prêtre, selon
les statistiques de la Congrégation du Clergé). La sécularisation qui frappe
l’Occident ne touche-t-elle pas le Nigeria ?
Cardinal Francis
Arinze – La sécularisation
touche plus ou moins tous les pays du monde. Il est vrai cependant que la
croissance du christianisme est la plus élevée en Afrique, non pas en chiffre
total, mais en pourcentage. Il ne manque pas de problèmes en Afrique :
l’instabilité de tel ou tel pays, des conflits, des guerres quelquefois. Mais
les gens acceptent le christianisme : devenir chrétien y est considéré
comme une bonne chose, ce qui est réconfortant. Il y a cependant beaucoup
de différences de l’Algérie, au Nord, à l’Afrique du Sud, de la Mauritanie,
à l’Ouest, à la Tanzanie. Mais puisque vous me parlez de mon pays, le Nigeria,
en effet, le nombre de chrétiens y est en croissance. Les églises bâties il
y a vingt ans ne suffisent plus. Quand un prêtre dit la messe les gens accourent,
quand un autre confesse ils font la queue. Beaucoup
de prêtres n’en peuvent plus, car ils ont énormément de travail. Le nombre
de jeunes entrant au séminaire est si élevé que nous parlons de boom.
C’est vrai aussi pour les religieuses. Par exemple, j’ai fondé à Umuoji,
dans l’archidiocèse de Onitsha, au Nigeria, une
communauté de bénédictines cloîtrées venant du Monte Mario à Rome, il y a
vingt-cinq ans, avec trois Italiennes et une Nigériane. Elles sont maintenant
cent quarante moniales professes à Umuoji, sans
compter celles qui ont été refusées et celles qui sont parties. Ce monastère,
au Nigeria, a fondé un autre monastère, avec quarante moniales, et envoyé
en Italie sept religieuses pour aider un monastère italien qui n’a plus de
candidates. Oui, le Seigneur nous donne la croissance. L’archidiocèse d’Onitsha,
avant d’être divisé l’année dernière, avait trois cent cinquante séminaristes
en philosophie et théologie et huit cents petits séminaristes. La paroisse
de la cathédrale envoie chaque année au moins vingt-cinq jeunes au petit séminaire,
presque tous enfants de chœur bien formés au service de l’autel. Un bon prêtre
ne manquera jamais de faire éclore des vocations, spécialement s’il porte
attention à la formation des enfants de chœur.
Il faut dire que les missionnaires d’Irlande
qui ont évangélisé notre pays ont fait du bon travail : catéchèse de
base, vie ecclésiale, sacrements. Il est vrai aussi que la providence divine
avait préparé les gens à recevoir l’Evangile. Les Européens parlent d’« animisme »
à propos des religions d’Afrique, pensant que les Africains étaient persuadés
que les arbres, les fleurs, la foudre avaient une âme. Il faut parler plutôt
de « religion traditionnelle », dans laquelle les gens croyaient
à un Dieu suprême, à un monde de bons et de mauvais esprits et d’un monde
des ancêtres. Quand les missionnaires sont venus, ils ont trouvé le terrain
préparé à la prédication de l’Evangile. Il y a eu
une « préparation évangélique ».
A ce propos, vous avez été précédemment président du Conseil pour le Dialogue
interreligieux. Le Nigeria, où se produit cette explosion du nombre des catholiques,
où les vocations sont nombreuses, est un pays musulman. On entend souvent
dire qu’il faut éviter le « prosélytisme », qu’il ne faut pas proposer
la conversion, mais uniquement dialoguer dans le respect de toutes les options
religieuses.
Je précise que le Nigeria n’est pas
un pays musulman. La majorité des Nigérians sont chrétiens, et leur nombre
augmente toujours. Il y a une majorité de musulmans dans certaines régions,
comme autour de Sokoto, Maiduguri et Kano. Mais il y a des diocèses du nord
du Nigeria qui ont cent prêtres autochtones. La réalité est en fait très diverse.
Le Concile Vatican II nous a donné
seize documents. Le document de base est Lumen gentium sur l’Eglise et sa nature de maison où sont invitées
à entrer toutes les nations, comme le dit son numéro 13. Le numéro 14
précise que c’est par la foi et le baptême que nous entrons dans l’Eglise.
Celui qui a pleine connaissance de cela et refuse d’entrer dans l’Eglise ne
peut être sauvé. Qui en a connaissance et sort de l’Eglise sera perdu. Autrement
dit, l’Eglise est nécessaire au salut, selon l’adage extra Ecclesiam, nulla salus, « hors
de l’Eglise point de salut », bien expliqué et avec toutes les précisions
qui s’imposent. Vatican II nous a aussi donné
la constitution Gaudium et spes : l’Eglise a les mains tendues
vers le monde. Le même Concile nous rappelle dans le décret Ad gentes qu’il faut évangéliser toutes
les nations. Saint Paul nous a dit : « Malheur à moi si je n’évangélise
pas ! » Jésus n’a pas fondé son Eglise pour être une académie de
dialogue, dans laquelle on argumenterait de manière acrobatique sur le thème :
« Nous sommes tous des amis ; nous restons où nous sommes ;
restez où vous êtes ; et à la fin nous nous retrouverons tous comme des
fils de Dieu ». Si les missionnaires avaient fait de tels raisonnements,
ils n’auraient jamais quitté leur pays, saint Boniface ne serait jamais allé
en Allemagne, saint Augustin de Cantorbéry n’aurait jamais été envoyé de Rome
en Angleterre, et les missionnaires irlandais ne seraient jamais venus au
Nigeria. Nous devons vraiment partager l’Evangile que nous avons reçu. D’ailleurs,
comme le pape Jean-Paul II l’a dit dans l’encyclique Redemptoris missio, la mission du salut
ne fait encore que commencer : les catholiques ne sont que 18 %
de l’humanité ; les autres chrétiens 15 % ; et tous les chrétiens
ensemble ne sont que 33 % de la population du monde. Et les autres ?
Ils ne seraient pas appelés à devenir fils de Dieu ? Jésus ne serait-il
pas mort sur la croix pour eux ?
Jésus est le seul sauveur et il n’en
est pas d’autre. Le Nouveau Testament est le dernier mot que Dieu avait à
dire aux hommes en son Fils unique fait homme, Jésus-Christ. Jésus est mort
sur la croix pour la rédemption de tous les hommes. Saint Paul dit à Timothée
que Dieu désire le salut de toute l’humanité. Or, il n’y a qu’un seul médiateur
de salut entre Dieu et les hommes : Jésus-Christ, dans lequel Dieu veut
que tous arrivent à la Vérité. Vatican II, dans la déclaration Nostra aetate, au numéro 2 a dit que l’Eglise respecte tout ce
qui est bon et vrai et saint dans toutes les religions, mais qu’elle annonce
et doit toujours annoncer Jésus-Christ, qui est la plénitude de toute la vérité.
Ceci est pour dire que le dialogue ne s’oppose pas à l’annonce du Christ.
Vous interprétez donc Nostra aetate, le document sur le dialogue interreligieux,
à la lumière d’Ad gentes, le document sur la mission de l’Eglise ?
On doit interpréter Nostra aetate à la lumière de Lumen gentium, naturellement, parce que
Lumen gentium est le grand document sur
la mission totale de l’Eglise. Nostra
aetate doit d’ailleurs être interprété aussi à la lumière de Ad gentes, de Gaudium et spes,
de Presbyterorum ordinis, le document sur le
sacerdoce. Ad gentes c’est l’ordre
du Christ : « Allez dans le monde entier, proclamez l’Evangile à
toute la création ! » Ou encore, en saint Matthieu : « Tout
pouvoir m’a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc, de toutes les nations
faites des disciples ! » Le dialogue est une des activités de l’Eglise,
mais il n’est pas toute l’activité de l’Eglise. Le service social est une
autre activité de l’Eglise – pensez au service des pauvres de la bienheureuse
Mère Teresa de Calcutta – mais le service social n’est pas tout l’Evangile.
Il faut aussi catéchiser, baptiser. C’est le même Jésus qui a donné à manger
le pain multiplié qui a dit aussi : « Qui ne croira pas, sera condamné ».
Oui, c’est le Jésus doux et humble de cœur qui a dit cela.
D’ailleurs, j’ai dix-huit ans d’expérience
du dialogue interreligieux et je dois dire que je n’ai jamais eu de problèmes
avec les membres d’autres religions de bonne volonté, qui comprennent que
nous avons notre identité catholique, et que puisque nous considérons que
notre foi est une bonne chose, il est normal que nous voulions la faire partager.
Non pas l’imposer, mais la proposer en toute liberté. Si celui auquel je propose
la foi en Jésus-Christ ne veut pas l’accepter, je n’utiliserai pas la force
physique, psychologique ou économique, pour le forcer à devenir chrétien.
Si j’utilisais la force pour l’obliger à croire, ce serait du « prosélytisme »
et je serais condamnable. Mais proposer le message évangélique et faire que
celui qui le reçoit l’accepte en toute liberté, ce n’est pas du « prosélytisme »,
c’est de l’évangélisation. Tous les hommes ont le droit
d’entendre parler de l’Evangile et nous avons, nous chrétiens, le devoir de l’annoncer. L’Eglise n’est pas notre propriété. Elle appartient
au Christ.
C’est pourquoi le pape écrit dans l’encyclique
Redemptoris missio, au numéro 55,
que le dialogue interreligieux fait partie de la mission évangélisatrice de
l’Eglise. C'est-à-dire qu’il est un élément du témoignage que nous donnons
du Christ. Si l’autre ne veut pas devenir chrétien au moins établissons-nous
des contacts et la grâce de Dieu travaille en lui comme en moi. Il est une
créature de Dieu et Jésus-Christ est mort pour lui. Nous pouvons écouter un
musulman ou un bouddhiste, travailler avec lui pour que le monde soit un peu
meilleur. Si un jour, il accepte de devenir chrétien, le dialogue cesse et
l’annonce commence. Et s’il ne veut pas devenir chrétien, nous devons continuer
à dialoguer avec lui : nous restons ainsi pour lui témoins du Christ.
Que l’autre croit ou ne croit pas, c’est Dieu qui jugera de son attitude vis-à-vis
de la grâce qu’il lui a donnée. Dieu n’a pas besoin de nous pour juger ;
il ne nous a pas faits membres de son conseil. Mais il est clair que le salut
vient uniquement par le Christ : chacun de ceux qui parviennent au ciel
y arrivent par la grâce de Jésus-Christ. Et si quelqu’un arrive au ciel sans
connaître expressément Jésus-Christ, il connaît alors qu’il a été sauvé lui
aussi par la grâce du Christ.
(publication dans L’Homme Nouveau, 7 décembre 2003)