« Les Nouvelles de Chrétienté »
n°4
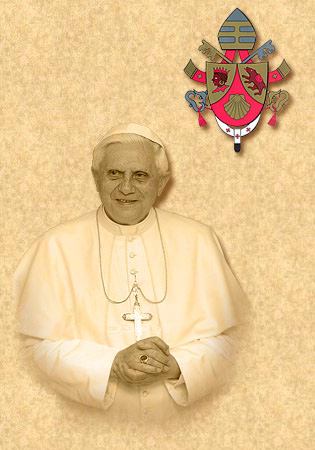
Avec l’aimable autorisation
de l’éditorialiste Michel De Jaeghere au Figaro Magazine, nous
publions dans ce numéro l’article de Monsieur l’abbé
Barthe, vaticaniste, sur Benoit XVI : Une
Vie
Benoit XVI : Une Vie
Le nouveau Pape a consacré
sa vie entière aux travaux théologiques et au gouvernement de
l’Eglise. Du concile Vatican
II à
Par
Claude Barthe
L’enfance d’un
pape
Josef
Ratzinger est né dans cette Bavière aussi romaine que germanique,
une Bavière chrétienne surtout, à Marktl am Inn, il y a 78
ans, le 16 avril 1927, non loin du grand sanctuaire marial
d’Altötting. C’était un Samedi Saint : Josef fut
baptisé, après la messe de la vigile de Pâques, que
l’on célébrait à l’époque le matin du
samedi, et au cours de laquelle toutes les cloches de la petite église
avaient sonné durant le gloria,
comme les cloches de Saint-Pierre de Rome ont sonné à la
volée, pour la première fois dans l’histoire des conclaves,
quand fut annoncée l’élection du même Josef, devenu
Benoît XVI.
Son
enfance, avec son frère et sa sœur aînés, se
déroula au rythme des fêtes et processions de cette Bavière
profonde, dans le décor de ses églises et chapelles baroques.
L’une des gendarmeries qu’ils habitèrent, du fait de la
profession de son père, était elle-même un ancien
bâtiment ecclésiastique. Les populations chrétiennes
d’alors, dans ces îlots de chrétienté que l’on
qualifiait de « terres à prêtres » vivaient
hier encore autour de leurs églises, d’une vie ordinaire ou
festive, ponctuée par les cérémonies du culte qui
recouvraient du berceau à la mort de chacun les actes les plus humbles
ou les plus solennels : Josef Ratzinger est sorti de ce monde-là.
Il
entra au séminaire en 1939, à la suite de son frère,
où il poursuivit, malgré la guerre qui pesait de plus en plus, de
bonnes humanités, et se passionna pour la littérature,
spécialement pour les auteurs allemands du XIXe siècle,
plus tard pour Gertrude von Le Fort, Dostoïevski, Claudel, Mauriac,
Bernanos. Après une courte période militaire dans une
atmosphère d’effondrement du Reich, il intégra le grand
séminaire de Freising, sous un préfet des études
newmanien, où il fit sa nourriture de Romano Guardini, Josef Pieper.
La
lecture de Steinbüchel, le personnaliste, l’a marqué, dont il
reliait la percée intellectuelle catholique – ce sera une
constante de sa recherche théologique – à celle, hors
catholicisme, de Martin Buber. Il adhérait avec plus de
difficulté au thomisme, et en rendra plus tard responsable la
néo-scolastique un peu close sur elle-même qu’il lui fut
donné de découvrir. La sensibilité de ses professeurs
– « retour à l’Écriture et aux
Pères » –, lors qu’il préparait sa
licence de théologie à Munich, correspondait à peu
près à celle à l’école dite « de
Fourvière » en France, qui se démarquait du thomisme
de stricte observance.
Il
fut impressionné par la pensée, et plus encore la manière
intellectuelle de Gottlieb Söhngen, un thomiste très
« dynamique ». Il sera toujours, intellectuellement et
moralement, un audacieux prudent. Pascher, un professeur de grande hauteur
spirituelle, le fit adhérer, au Mouvement liturgique, dont
l’historicisme l’avait jusque-là rebuté. Il
élargit ses horizons en lisant le livre majeur du P. de Lubac, Catholicisme. Il n’est pas
entièrement convaincu par son professeur d’exégèse,
le célèbre Maier (quelque chose comme un blondélien), qui
fut son professeur, mais celui-ci excite cet intérêt théologique
très particulier qu’il aura toujours pour
Après
son doctorat sur saint Augustin, il devint professeur de dogmatique à
l’école supérieure de philosophie de Freising, cependant
que sa thèse d’habilitation sur le thème de
Le temps du Concile
Le
cardinal Frings le fit nommer expert au Concile dès la fin de la
première session, en 1962. Il joua dès lors un rôle
particulièrement actif, collaborant notamment avec Rahner dans le
débat sur
Mais
l’expert Ratzinger restait du côté des conciliaires
décidés. Lorsque, dans la réunion conciliaire dramatique
du 8 novembre 1963, le cardinal Frings, pratiquement aveugle, se dressa contre
le cardinal Ottaviani, presque aveugle lui aussi, en accusant le Saint-Office
que présidait ce dernier, de juger et condamner sans entendre les
personnes visées, et d’user de « méthodes ne
correspondant plus aux conditions modernes », tout le monde pensa
que Josef Ratzinger avait préparé cette terrible invective que la
majorité conciliaire applaudit à tout rompre. Si cela a
été, le discours que Josef Ratzinger prononça devant toute
Mais
après l’enthousiasme de la première session, au fur et
à mesure qu’avançait le Concile, l’effervescence
malsaine qui se développait le gênait au même titre
qu’elle inquiétait les PP. de Lubac, Daniélou,
Grillmeier et autres. Josef Ratzinger se situait au sein de ce
« tiers parti », entre les théologiens franchement
modernistes, de type Küng et Schillebeeckx, et l’orthodoxie
intransigeante de la minorité conciliaire du cardinal Ottaviani. Ce
« tiers parti », qui avait pris les rênes
dès les premiers jours de Vatican II en écartant toute la
préparation réalisée par
Par
Hans Urs von Balthasar, il a connu dès
l’origine l’un de ces nombreux mouvements qui, sous des aspects
divers, vont représenter une réaction à la crise de
l’Église venant non du sommet, mais de la base, à la
manière d’anticorps : le mouvement Communion et Libération fondé par l’Italien Don
Giussani. C’est avec des œuvres, mouvements et courants de ce type
que Josef Ratzinger, devenu plus tard, de fait, le deuxième personnage
de l’Église, sera en parfaite syntonie dans sa recherche
d’une sortie de la crise.
Après le Concile
Même
si les textes de Josef Ratzinger étaient ceux d’un partisan
foncier de Vatican II, comme en témoigne le livre que citent
toujours les théologiens progressistes pour montrer qu’il les a
« trahis » : Le
nouveau peuple de Dieu, paru en France en 1971 (Aubier), ses
réserves vis-à-vis de « l’esprit du
Concile » allaient croissant. Impressionnante est la somme des
jugements extrêmement sévères, que l’on pourrait
aligner aujourd’hui, portés par lui, à partir de cette
époque, sur le thème : l’Église a
été blessée par des évêques qui se sont
alignés sur des théologiens libéraux.
Il
lança son premier signal d’alarme public dans une
conférence à Münster, puis un autre à Bamberg, au
Katholikentag de 1966. Trois ans avant la promulgation de la réforme
liturgique de Paul VI, il attaquait déjà le
« nouveau ritualisme » des experts en liturgie, qui
remplaçaient les usages anciens par la fabrication de
« formes » et de « structures »
suspectes (face-au-peuple obligatoire, par exemple). Pour la première
fois de sa vie, il s’entendit qualifier de
« conservateur » (par le cardinal Döpfner).
Devenu
professeur de dogmatique à Münster, il est nommé professeur
à Tübingen à la fin de 1966. C’est là
qu’il assiste effaré au Mai 68 à l’allemande,
c’est-à-dire à la marxisation (Ernst Bloch dominait le
corps professoral) d’une université qui avait
précédemment été minée par la
théologie de Bulmann. Époque formatrice mais épuisante
qu’il abrégea en acceptant un poste de professeur de
théologie dogmatique et d’histoire des dogmes à Ratisbonne,
en 1969, en même temps qu’il était nommé membre de
C’est
aussi à Ratisbonne, en 1977, que lui parvient sa nomination directe par
Paul VI à l’un des plus importants sièges
d’Allemagne, celui de Munich et Freising. Il a 49 ans. Consacré le
28 mai, il est propulsé au cardinalat un mois plus tard, le 27 juin 1977
par Paul VI, qui mourrait l’été suivant, le 6
août 1978.
Et
Ratzinger devint l’un des premiers wojtyliens. Il avait en effet connu, lors du Concile,
l’évêque auxiliaire puis archevêque de Cracovie, Karol
Wojtyla, de sept ans son aîné, dont il apprécia
d’emblée la personnalité hors du commun, sans pour autant
s’intéresser à l’œuvre à laquelle le
Polonais collaborait, la « Constitution sur l’Église
dans le monde de ce temps », Gaudium
et spes, un texte qui ne l’a jamais enthousiasmé et qui
apparaît aujourd’hui comme le plus daté de Vatican II.
Lors du premier conclave de l’été 1978, qui devait
élire l’éphémère pape Luciani,
Jean-Paul Ier, le tout nouveau cardinal Ratzinger fit partie de
ceux qui lancèrent « l’hypothèse
Wojtyla », avec les cardinaux Koenig,
de Vienne, et Hoeffner, de Cologne. Lors du conclave d’octobre, ils
remettent la candidature d’Europe de l’Est sur le tapis, et cette
fois avec succès.
Depuis
dix ans déjà, la plupart des allocutions de Paul VI
faisaient état de ses inquiétudes au sujet de
l’« autodémoliton » de l’Église.
La phase explosive de la crise s’est située à la fin des
années soixante et au cours des années soixante-dix.
L’aspect le plus douloureux, et aussi le plus compromettant pour
l’avenir, était assurément le bouleversement qui affectait
le monde des clercs et religieux. Ce fut l’époque de très
nombreux « départs » dans les diocèses et
dans les couvents, sur fond de remise en cause du célibat
ecclésiastique, cependant que la courbe des vocations
s’effondrait. Les séminaires diocésains fermaient les uns
après les autres.
En
1978, l’état de l’Église était donc critique,
moins assurément qu’aujourd’hui, mais les
ébranlements internes avaient rencontré la crise de
société de 1968, dans laquelle l’extrême
modernité battait en brèche tous les autres
« magistères », dans l’État, la
famille, l’enseignement. Si l’on était resté
indéfiniment au milieu de cette zone d’extrême turbulence,
l’œuvre conciliaire se serait évanouie dans un croissant désordre.
L’étape nouvelle, qui s’ouvrit en 1978, était donc
rendue nécessaire pour la préservation de l’héritage
conciliaire.
Le
25 novembre 1981, Jean-Paul II appelait donc le cardinal Ratzinger
auprès de lui pour lui confier dans ce contexte la charge de
préfet de
La somme théologique
Jamais
pontife n’aura laissé derrière lui autant de textes,
discours et documents. Des textes, des montagnes de textes, auxquels il faut
ajouter ceux des congrégations romaines, spécialement de
Qu’il
lui ait fallu composer avec d’autres sensibilités est
évident. Mais il n’est pas exagéré de dire
qu’il a promu les grandes encycliques morales : Veritatis splendor, du 6 août 1993, sur les fondements de la
morale catholique, Evangelium vitae,
du 25 mars 1995, sur la valeur et l’inviolabilité de la vie. Dans
le domaine brûlant de l’œcuménisme : l’encyclique
Ut unum sint, du 25 mai 1995, tente
de lui donner une définition. Mais aussi : l’encyclique Fides et Ratio, du 14 septembre 1998,
sur les rapports de la foi et de la raison, l’encyclique Ecclesia de Eucharistia, du 17 avril
2003, sur l’eucharistie dans son rapport avec l’Église.
Sans
parler des instructions de
Deux
textes, deux textes ratzinguériens, certes très inégaux
dans leur degré de solennité mais d’un intérêt
égal en ce qu’ils représentent, sont
particulièrement importants et lourds de conséquence pour
l’évolution future du magistère post-conciliaire.
C’est la lettre apostolique Ordinatio
sacerdotalis, du 22 mai 1994, sur l’ordination sacerdotale
exclusivement réservée aux hommes, dont la forme se rapproche
apparemment le plus du magistère dogmatique d’antan, d’avant
Vatican II. Mais c’est aussi l’instruction Donum vitae, du 22 février 1987.
Il
est clair que l’ensemble des documents moraux du pontificat de
Jean-Paul II se sont inscrits dans la suite de l’encyclique Humanae vitae, de Paul VI, du 25
juillet 1968. Ce document a donné la couleur morale spécifique du
pontificat de Jean-Paul II. Mais les moralistes savent bien qu’Humanae vitae n’apportait rien de
neuf et que la doctrine de l’encyclique se trouvait déjà
dans le magistère de Pie XII, qui avait condamné la
contraception artificielle, la « pilule », dès
1951. En revanche,
l’instruction Donum vitae,
signée par le cardinal Ratzinger, non seulement assumait l’enseignement
précédent, mais elle intervenait de manière nouvelle sur les problèmes
inédits qui se posaient dans le domaine dit de la bioéthique, en
fonction de l’apparition des techniques de procréation
assistée. Comme Ordinatio
sacerdotalis en 1994, ce texte de 1987, rédigé avec la
collaboration de Mgr Carlo Caffarra (un des meilleurs spécialistes
du magistère de Pie XII, alors président de l’Institut
Jean-Paul II, devenu depuis archevêque de Ferrare puis de Bologne),
tranchait à nouveaux frais, dans le sens traditionnel, comme le faisait
le magistère pontifical d’avant Vatican II, sur des questions
nouvelles surgissant dans les domaines de la foi et de la morale.
Les batailles
C’est
une vraie guerre d’usure avec les forces centrifuges, qu’a
menée le Préfet de
Évoquons
seulement la bataille avec la théologie de la libération, qui vit
le jour dans les années qui ont suivi le Concile
– c’est le Mai 68 d’Amérique latine, si on
veut – avec des théologiens comme Gustavo Gutièrrez,
du Pérou, les frères Clodovis et Leonardo Boff, du Brésil,
Jon Sobrino, le jésuite Segundo à un moindre degré. Leurs
écrits réinterprétaient l’Évangile à
la lumière de pans entiers de la théorie marxiste. Appuyés
par les communautés de base, ils étaient soutenus par des
évêques comme MgrCâmara ou le cardinal Aloisio Lorscheider.
Certains d’entre eux en arriveront à se joindre aux mouvements de
guérillas dans diverses contrées, tel le P. Camillo Torres
en Colombie, et plusieurs prêtres dans le mouvement
révolutionnaire du Salvador ou dans le Front sandiniste de
Libération nationale, au Nicaragua.
Le
basculement de tendance se manifestera entre les IIème et IIIème conférences
générales de l’épiscopat latino-américain,
réunies à Medellin (Colombie) en 1968 et à Puebla
(Mexique) en 1979, d’une part, et
Cette
théologie mode 68 s’est, depuis 1989, reconvertie en revendications ultra-libérales, rejoignant
celles des contestataires d’Occident en faveur de la structure
démocratique de l’Église, du sacerdoce des femmes, de la
libéralisation morale. Les sanctions (quelques interdictions
d’enseigner dans des chaires d’universités catholiques)
ont-elles été à la mesure de la contestation d'un
Eugen Drewermann, qui affirmait que les réponses données par les
religions non chrétiennes aux grandes interrogations des hommes sont
parfois mieux adaptées que celles du christianisme, d’un Charles
Curran, qui rejetait en bloc l’enseignement moral de
l’Église, d’un Knitter, Guindon, Küng, Schillebeecks,
etc. ?
Ce
furent aussi des Déclarations très médiatisées de
théologiens de cette ligne, comme celle de Cologne (janvier 1989), qui
demandait que le Concile ne soit pas
« arrêté ». À Washington
(février 1990), 4500 signataires réclamaient l’abolition de
la « discipline médiévale » qui impose le
célibat aux prêtres, le sacerdoce des femmes et des hommes
mariés, y compris les prêtres qui se sont
« retirés ». À Lucerne (mars 1991), huit
mille signataires, prêtres, religieux, diacres, théologiens, qui
« ne peuvent plus se taire », exigeaient davantage de
démocratie, moins d’exclusions (les divorcés
remariés écartés de la communion sacramentelle). Si la
surenchère a cessé, les revendications demeurent « sur
le terrain », et il est peu probable que l’« instruction sur la vocation ecclésiale du
théologien » (24 mai 1990), ainsi que
Au secours de la doctrine
On peut voir dans l’instruction
Dominus Jesus, sur l’unicité et l’universalité
salvifique de Jésus-Christ et de l’Église, du 6 septembre
2000, une espèce de sommet. Le
travail avait été mis en branle par un livre du P. Jacques
Dupuis, jésuite, synthèse des revendications des
théologiens des religions, Vers
une théologie chrétienne du pluralisme religieux (Cerf,
1997). Sur le fond, c’est en direction des dérives de la
théologie des religions, du « relativisme » et de
l’« indifférentisme » qu’elles
induisent, que
Jamais
texte ratzinguérien n’avait autant été
critiqué depuis son livre ; Entretien
sur la foi (Fayard, 1985). C’est, en effet, alors, en 1985, que
Ratzinger est devenu Ratzinger, et à commencé l’ascension
qui s’achève aujourd’hui. Il avait donné à
Vittorio Messori, dans le mensuel italien Jesus,
un entretien ensuite publié sous forme de livre : « Si
par restauration, l’on entend
un retour en arrière, alors aucune restauration n’est possible.
L’Église marche vers l’accomplissement de l’histoire,
elle regarde en avant vers le Seigneur qui vient. […] Mais si par restauration on entend la recherche
d’un nouvel équilibre, après les interprétations
trop positives d’un monde agnostique et athée, eh bien alors, une
restauration entendue en ce sens-là, c'est-à-dire un
équilibre renouvelée des orientations et des valeurs à
l’intérieur de la catholicité tout entière, serait
tout à fait souhaitable ».
L’analyse
des bilans, inflexions, alarmes de cet ouvrage a été souvent
faite. Concrètement, il sera le vecteur de la
« remontée de l’intérieur », selon
l’expression qu’aime Josef Ratzinger. Elle portera essentiellement
sur l’enseignement du catéchisme. On vit d’ailleurs en cette
occasion pour la première fois, dans toute son ampleur, ses
capacités stratégiques, faites au fond d’une patiente et
constante détermination.
Déjà, il avait donné en 1983 deux
conférences à Notre-Dame de Paris et à Notre-Dame de Fourvière
sur la
« nouvelle catéchèse », qui affirmait que
le genre littéraire du catéchisme, avec sa synthèse
fondée sur le commentaire du Credo,
des sacrements, des commandements et du Pater
(autrement dit le schéma du Catéchisme du Concile de Trente et du
Catéchisme de saint Pie X), n’était pas
dépassé.
Vint
donc ensuite l’Entretien sur la
foi : « Comme la théologie ne semble plus à
même de transmettre un modèle commun de la foi, de même la
catéchèse est exposée au morcellement, à des
expériences qui changent constamment. Certains catéchismes et de
nombreux catéchistes n’enseignent plus la foi
catholique ».
Se
tint alors un Synode extraordinaire des Évêques, à Rome, en
novembre et décembre 1985, à l’occasion du 20ème
anniversaire de la conclusion de Vatican II, dont les débats furent
implicitement dominés par la bombe Ratzinger, l’Entretien sur la foi. On crut le résultat en sa
défaveur : il avait voulu un bilan des années conciliaires,
on avait procédé à une célébration. En fait
il avait réussi : dans le discours de conclusion du Synode, le pape
n’annonçait qu’une seule mesure (outre une codification des
règles propres aux Églises orientales), la mise en chantier
d’un Catéchisme de
l’Église catholique. Il fut promulgué après sept
ans de préparation le 11 octobre 1992.
Organisé selon le schéma du Catéchisme du Concile de Trente,
ce compendium rappelle l’ensemble de la doctrine catholique, sans omettre
de faire une part importante – ce que les médias ont bien
entendu relevé avec prédilection – aux questions
morales. Il avait fallu attendre trente ans après l’ouverture du
Concile pour qu’une telle parution soit possible.
En
fait, cette idée de publier un catéchisme, relevée par
Jean-Paul II comme représentant le vœu unanime et le plus
important du synode extraordinaire, n’avait été
émise que par un seul des Pères du synode, le très
conservateur cardinal Oddi, dont on savait par ailleurs qu’il jouait le
rôle de médiateur de facto
entre le Saint-Siège et
Réformer la
réforme
A
la fin du Synode de 1987, le cardinal Ratzinger annonça aux
évêques qu’un Visiteur apostolique avait été
nommé pour l’œuvre de Marcel Lefebvre : le cardinal
canadien Édouard Gagnon, président du Conseil pour
On
ignorait généralement que le cardinal Ratzinger avait pris en
charge cette affaire depuis son installation dans le palais du Saint-Office, et
qu’elle lui tenait très à cœur pour plusieurs raisons.
Il était d’abord convaincu tant par lui-même que par
certains amis proches, que les « revendications »
lefebvristes, spécialement les revendications liturgiques, trouvaient un
écho favorable bien au-delà des aires traditionalistes. En outre,
il pensait – comme beaucoup d’autres prélats romains –
que la réintégration du lefebvrisme serait fort utile pour faire
contre poids aux « excès » progressistes. Et plus
profondément, il estimait que, du point de vue liturgique, le
lefebvrisme était dans son droit.
Il
faut dire aussi que la pression avait monté considérablement
depuis la spectaculaire Journée d’Assise, d’octobre
1986 : les déclarations de Mgr Lefebvre contre
« l’Église conciliaire » se faisaient
toujours plus dures, et toujours plus précises ses menaces de consacrer
des évêques pour continuer à ordonner des prêtres
célébrant la messe selon le rite d’avant Vatican II. La
mission du cardinal Gagnon eut pour principal résultat de
s’entendre confirmer de la bouche du prélat
d’Écône que le temps pressait : il savait que ses jours
étaient comptés.
Du
12 avril au 4 mai 1988, eurent lieu des discussions, à Rome, entre le
cardinal Ratzinger, Mgr Lefebvre à propos d’un accord
disciplinaire. Cet accord du 5 mai (fête de saint Pie V) érigeait
Quelques
semaines plus tard, devant les évêques du Chili, le cardinal
Ratzinger s’interrogeait sur ce qui avait conduit à cette rupture
des traditionalistes : « Le second concile du Vatican
n’est pas abordé comme une partie de l’ensemble de
Une partie du monde
traditionaliste, spécialement le monastère du Barroux,
acceptèrent une « paix séparée »,
qui sera concrétisée par un motu
proprio du 2 juillet 1988 : Ecclesia
Dei adflicta. Supervisés par une Commission pontificale logée
dans le palais du Saint-Office, les prêtres traditionnels allaient
pouvoir constituer des instituts dépendant directement de cette
commission et non des évêques. En outre, était
confirmée la lettre de
Pour ce qui dépend
de Benoît XVI, elle liera assurément, d’une manière
ou d’une autre, deux certitudes qui l’habitent, depuis qu’il
est en charge du problème, c'est-à-dire depuis 1982. D’une
part, compte tenu de la manière
« révolutionnaire » dont a procédé,
selon lui, la réforme de Paul VI, la liturgie antérieure ne peut
pas être considérée comme abrogée : il faut
donc lui assurer une place officielle. D’autre part, la réforme de
Paul VI, après 35 ans d’usage n’a pas donné les
fruits que l’on en espérait : il faut donc, en douceur et
avec patience, procéder à une « réforme de la
réforme », qui la ramène dans la ligne des
réformes accomplies par Pie XII à l’époque du
Mouvement liturgique. Ce qui n’est qu’un élément
d’un plus vaste programme.
Révolution
conservatrice
Car
ce qui a fait l’élection du pape Ratzinger, c’est
l’appoint décisif que lui a apporté le cardinal Camillo
Ruini, Vicaire de Rome et président de la conférence
épiscopale italienne. Ces deux intellectuels se sont accordés sur
un constat et sur un programme qui a convaincu les deux tiers du Sacré
Collège.
Ce
« programme » est celui d’une reprise forte du
gouvernement de l’Église, une purification de ses « vêtements et de son visage si sales »,
selon les expressions de Josef Ratzinger dans le Chemin de Croix au
Colisée, du 25 mars. Benoît XVI propose un renforcement de la
formation doctrinale et morale du clergé. Il croit à une relance
effective de l’évangélisation et de l’enseignement du
catéchisme. Il espère en un relèvement qualitatif des
célébrations eucharistiques. Ils sont prêts à lancer
une nouvelle campagne missionnaire.
Il est surtout convaincu que la vraie bataille de
l’Église ne sera pas contre l’islam – même
s’il peut faire beaucoup de victimes et de martyrs – ni contre les autres
religions. Il partage, à cet égard, le jugement
déjà ancien de Urs von Balthasar : devant la
modernité, seul le christianisme, s’il veut se présenter
comme tel, fait le poids. Selon Benoît XVI et les ratzinguériens, le conflit à venir
c’est d’abord le conflit culturel entre l’Église et
« la radicale émancipation de l’homme vis-à-vis
de Dieu et des racines de la vie », qui caractérise la
culture occidentale devenue la culture mondiale, et qui, au nom de la
liberté absolue amène à la destruction de toute
liberté.
Pour ces penseurs – mais seront-ils aussi des pasteurs
efficaces ? – l’Église devra trouver des alliés
proches ou lointains, comme a tenté de le faire leur mouvement de
référence, Communion et Libération.
Il y a quinze ans déjà, le 1er septembre
1990, à Rimini, précisément lorsqu’il concluait un Meeting de Communion et Libération, Josef
Ratzinger avait parlé de l’Église « toujours
à réformer ». Sans évoquer Vatican II, il traitait de la réforme,
non pas à continuer, non pas à appliquer, non pas à
réactiver, mais de la réforme à faire, et même
« à découvrir ».
Il
stigmatisait « la réforme inutile », celle qui,
intégrant le modèle de la liberté des Lumières,
voudrait que l’on passe d’une Eglise
« paternaliste » à une Eglise démocratique
surgie dans les discussions et les compromis, à une Eglise dont les
formules de foi sont abrégées, dont la liturgie est
refabriquée en permanence par les communautés vivantes. Eglise
purement humaine, qui repose sur les décisions de la majorité du
moment. Le futur Benoît XVI précisait pour l’avenir que
« l’essence de la vraie réforme » consistera
en une ablatio de toutes les scories
qui obscurcissent l’image de l’Eglise. Et s’élevant au
ton d’une haute méditation théologique, il appliquait aux
mauvais pasteurs, qui ne croient plus au péché, la phrase
mordante de Pascal aux jésuites : « Ecce patres, qui tollunt peccata mundi ! Voici les
Pères qui enlèvent les péchés du
monde ».
S’il
s’agit bien, comme on nous le dit, d’un « pape de
transition », il s’agirait pour le coup, d’une
transition vers des rives toutes nouvelles.